Le site archéologique de Santa Maria di Nabui est situé à environ 20 km au nord de Guspini, le long de la route qui mène à la station balnéaire de Torre dei Corsari, en passant par la ville de Sant'Antonio di Santadi. Il est situé dans une étroite plaine alluviale, délimitée au sud par une zone vallonnée, au nord par l'étang de Sa Salinedda et le plus méridional des étangs de Santa Maria.
Situées à environ 20 km au nord de Guspini, les ruines du site appelé « Santa Maria di Nabui » sont situées dans une plaine alluviale dont les terres ont été récupérées pour faciliter l'établissement d'activités agricoles menées dans la région depuis des siècles.
HABITÉE DEPUIS LE NÉOLITHIQUE, ELLE EST DEVENUE LE SITE D'UN PORT DE COMMERCE DÈS LE BRONZE FINAL, POUR ÊTRE TRANSFORMÉE EN EMPORIUM PAR LES PHÉNICIENS ET FONDÉE EN TANT QUE VILLE PAR LES PUNIQUES DE CARTHAGE. À l'époque romaine, la vocation commerciale du centre s'est poursuivie, stratégique pour le commerce des céréales et des ressources métalliques provenant de l'arrière-pays : les vestiges de structures d'habitation, d'un aqueduc, d'une route et de thermes sont encore visibles. La continuité de vie du centre habité est attestée depuis des siècles : dans la Cosmographie de l'Anonyme Ravenne, Néapolis est mentionnée parmi les villes de l'île de Sardaigne. En particulier, une partie du bâtiment thermal construit selon la technique de l'opus caementicium et les murs extérieurs et intérieurs en opus vittatum mixtum avec des bords de murs en briques, dont la construction remonte à la fin de l'époque impériale (II-III siècle après JC), situé dans le secteur sud-est de la ville antique, a été réutilisée jusqu'au XVIIIe siècle comme église dédiée à la Vierge de Santa Maria de Nabui. Le bâtiment dédié au culte chrétien a été construit dans un environnement thermique rectangulaire spacieux, voûté dans un tonneau. À l'occasion de cette intervention, une grande ouverture rectangulaire placée sur le petit côté de la pièce a été bouchée. La structure, qui a été gravement endommagée et a récemment fait l'objet de travaux de consolidation et de restauration, a été surélevée d'environ 3,1 m, tandis que certaines parties du sol d'origine sont conservées. Les murs intérieurs présentent des traces de plâtre sur lesquelles sont encore visibles des graffitis et des monogrammes christologiques, qui remontent à l'utilisation de l'environnement comme édifice religieux. Dans l'état actuel des recherches archéologiques, on ne sait pas exactement quand le bâtiment thermal a été transformé en église de culte chrétien : à partir de certaines comparaisons avec des contextes sardes similaires, également sujets à un changement de destination de l'utilisation thermale (Sant'Andrea di Pischinappiù di Narbolia, Santa Maria di Vallermosa, Santa Maria di Mesumundu, sanctuaire de Notre-Dame de Bonacattu à Bonarcado), le passage serait semblent pouvoir être placés au début du Moyen Âge ou au plus tard à l'ère vandale.
L'église semble avoir été pleinement opérationnelle jusqu'au XVIIIe siècle : des rites chrétiens y étaient encore célébrés lorsqu'elle a été interdite par Mgr Pilo, évêque d'Ales-Terralba, car elle est devenue un refuge pour les trafiquants.
Histoire des fouilles et des études
La région de Néapolis est connue dans la littérature depuis l'Antiquité : Pline l'Ancien, au premier siècle avant notre ère, dans le troisième livre de sa Naturalis Historia, énumère parmi les peuples et les villes de la Sardaigne romaine, dix-huit oppida, dont quelques civitates stipendiariae habitées par des pèlerins (Sulci, Valentia, Neapolis, Bitia) ; elle est mentionnée comme centre côtier par Ptolémée (III, 3, 2), qui inclut la ville parmi les pôles de la côte ouest de l'île de l'île de la Sardaigne ; de plus, son identification avec le portus de Neapolitanus, connu grâce aux portolani et aux cartes marines du XIIIe siècle, est aujourd'hui sans équivoque, de même que la mention du Domo de Neapolis, faisant référence à un modeste village rural mentionné dans des documents datant du milieu du XIIIe siècle, semblent faire référence à ce contexte.
L'importance du contexte archéologique était déjà évidente au XIXe siècle lorsque Vittorio Angius a décrit l'extension de la colonie essentiellement commerciale et les caractéristiques des urgences monumentales.
Les recherches archéologiques dans la région ont débuté au milieu du XIXe siècle et ont repris en 1951, mais elles ont été activées de manière intense et presque continue depuis les années 1970 du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui.
Bibliographie
R. Martorelli, Les villes de Sardaigne entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, à S. Angiolillo, R. Martorelli, M. Giuman, D. Artizzu, Sardaigne romaine et début du Moyen Âge. Histoire et matériaux, série « Corpora delle Antiquità della Sardegna », Sassari 2017, p. 265-278 ;
E. Usai, M. Casagrande, C. Oppo, L. Garau, A. Loy, P. G. Spanu, R. Zanella, R. Zanella, R. Zucca, Le paysage du pouvoir urbain dans une ville sardo-romaine : les « grands bains » de Neapolis, dans M.B.C., A. Gavini, A. Ibba (édité par), Roman Africa. Transformation des paysages du pouvoir en Afrique du Nord jusqu'à la fin du monde antique. Actes de la XIXe conférence d'étude. Sassari, 16-19 décembre 2010, Rome 2012, p. 1905-1929 ;
P. G. Spanu, Sardaigne byzantine entre le VIe et le VIIe siècle, série « Méditerranée de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge. Excavations et recherches », 12, Oristano 1998, p. 56-58, 131-143 ;
P. G. Spanu, La structure urbaine de la ville romaine, dans R. Zucca (édité par), Splendidissima Civitas Neapolitanorum, Rome 2005, p. 245-279 ; R. Zucca, Splendidissima Civitas Neapolitanorum, Rome 2005 ; R. Zucca, Neapolis et ses territoire, Oristano 1987 ; C. Puxeddu, romanisation, dans le diocèse d'Ales-Usellus Terralba. Aspects et valeurs, Cagliari 1975, p. 165-221 ;
G. Spano, Description de l'ancienne Néapolis, dans « Bulletin archéologique sarde, collection de monuments anciens de toutes sortes provenant de toute l'île de Sardaigne », n. 9, Cagliari 1859, p. 129-137.
Comment s'y rendre
Prenez la SS 130 jusqu'à l'embranchement pour Villasor et prenez la SS 196 qui mène à Guspini. Une fois dans la ville, empruntez la SS 126 jusqu'au km 94, puis tournez en direction de Sant'Antonio di Santadi. Depuis la bifurcation, parcourez environ 15 km et tournez vers une route de pénétration agraire. Après environ 200 m, vous êtes dans la zone archéologique.
Type de contenu:
Architecture religieuse
Province: Sardaigne du Sud
Commun: Guspini
Zone macro territoriale: Sardaigne du Sud
CODE POSTAL: 09036
Adresse: SP 65
Mise à jour
Où est-il
Images
Des textes
Vidéo

Auteur : Spadetta Giulio
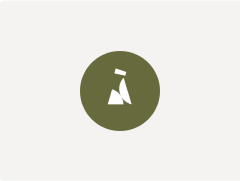
Résultats 2 de 49417
Voir toutl\'audio
commentaires